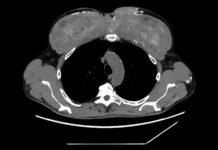Les premières sociétés humaines à grande échelle – les premiers États – sont probablement issues non pas d’un progrès naturel, mais d’une réalité économique brutale : une production céréalière facile à taxer. De nouvelles recherches suggèrent que l’essor des États n’a pas simplement été « rendu possible » par l’agriculture, mais directement « motivé » par la nécessité d’extraire des surplus grâce à la fiscalité, et que l’écriture elle-même s’est développée comme un outil de tenue de registres dans ce système.
Les origines mafieuses du pouvoir
Pendant des siècles, les chercheurs se sont demandé si l’agriculture avait donné naissance à la civilisation ou s’il s’agissait simplement d’une adaptation désespérée. La nouvelle étude, dirigée par Kit Opie (Université de Bristol) et Quentin Atkinson (Université d’Auckland), suggère une vérité plus cynique : l’agriculture intensive a créé des excédents imposables, et ces excédents ont permis aux États de se constituer en rackets de protection. Ces premiers États n’ont pas attendu que l’agriculture conduise à la complexité ; au lieu de cela, ils l’ont forcé par le contrôle.
La chronologie est révélatrice. L’agriculture est apparue il y a environ 9 000 ans sur plusieurs continents, mais les sociétés à grande échelle n’ont suivi que 4 000 ans plus tard, d’abord en Mésopotamie, puis ailleurs. Ce retard n’est pas dû au fait que l’agriculture a mis du temps à se développer, mais au fait qu’il a fallu du temps aux États pour consolider et extraire efficacement les ressources.
Pourquoi les céréales, pas les racines ?
L’étude a utilisé des données linguistiques et anthropologiques pour modéliser la probabilité que des événements historiques se produisent en séquence. Les résultats ont été frappants : les États ont presque invariablement émergé dans des sociétés productrices de céréales (blé, orge, riz, maïs). Mais pourquoi les céréales ?
La réponse est simple : les céréales sont faciles à taxer. Il pousse dans des champs fixes, mûrit de manière prévisible et peut être stocké indéfiniment. En comparaison, les plantes-racines comme les pommes de terre ou le manioc ne sont pas imposables. Les États n’ont pas seulement bénéficié des céréales ; ils l’ont activement promu au détriment des autres cultures. Opie soutient que les premiers États ont probablement supprimé les cultures de racines et les arbres fruitiers parce qu’ils ne pouvaient pas être taxés aussi efficacement.
L’écriture comme outil de contrôle
Le lien entre fiscalité et écriture est également clair. L’étude a révélé que l’écriture apparaissait rarement dans les sociétés sans impôts, mais apparaissait presque toujours là où les impôts étaient collectés. Les élites utilisaient l’écriture pour enregistrer leurs dettes, faire valoir leurs revendications et légitimer leur pouvoir. Essentiellement, l’alphabétisation n’était pas un sous-produit de la civilisation ; c’était un outil pour maintenir la hiérarchie sociale émergente.
Le coût du contrôle
Même si l’agriculture céréalière a alimenté la croissance démographique au cours de la période néolithique, elle a eu un coût élevé : une santé en déclin, un retard de croissance et une santé dentaire de moins bonne qualité. En effet, le contrôle centralisé de la production alimentaire signifiait moins de diversité alimentaire et une plus grande dépendance à l’égard d’une seule culture facilement imposable. Les effets de ce changement se font encore sentir aujourd’hui.
Vue d’ensemble
La méthodologie de l’étude – appliquer des modèles évolutionnistes au développement culturel – est innovante mais n’est pas sans critiques. Certains archéologues affirment que la relation entre l’agriculture et la formation de l’État variait considérablement selon les régions. Par exemple, la formation précoce de l’État en Égypte semble liée aux rituels royaux plutôt qu’à la simple fiscalité.
Cependant, l’argument central reste puissant : les premiers États ne sont pas nés de la bienveillance ou du progrès, mais de la coercition et de la nécessité d’extraire des ressources. Les fondements mêmes de la civilisation ont été construits sur le dos d’agriculteurs contraints de produire des surplus imposables, l’écriture servant de registre de leur exploitation.
Les preuves suggèrent que les premiers États étaient essentiellement des rackets de protection, garantissant la défense des champs en échange d’une coupe. Cette prise de conscience est une vérité dure mais nécessaire pour comprendre les origines du pouvoir et des inégalités.